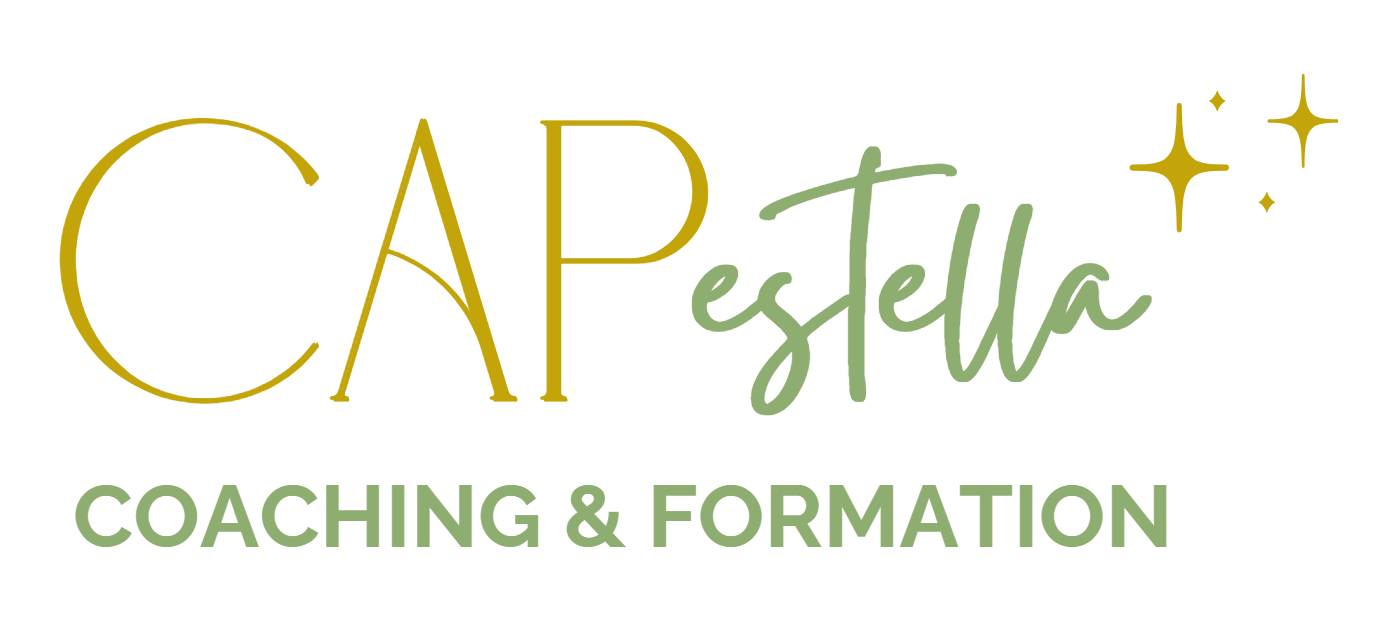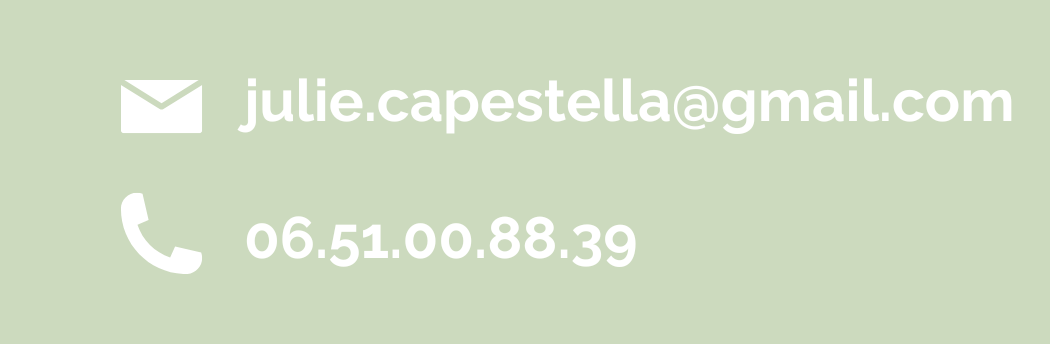Effets du stress sur le corps et le cerveau
Le Docteur Hans Selye, pionnier des études menées sur le stress, a introduit le concept suivant : tout changement est source de stress et nécessite un effort d’adaptation. La vie étant une succession de changements, le stress et ses effets sur le corps et le cerveau nous accompagnent tout au long de notre vie.
Examen, arrivée d’un enfant, divorce, licenciement, rupture, changement d’emploi, décès, conflits… le stress fait partie intégrante de notre quotidien. De base, le stress est une réaction physiologique normale de notre organisme. Il vise à nous protéger face à un changement, une menace ou une pression. Mais dans nos vies modernes, il a tendance à être constamment présent, impliquant que notre corps reste en alerte constante. Le stress cesse alors d’être un mécanisme de protection. Il devient un stress chronique qui, sur la durée, entraîne des répercussions profondes sur notre santé. Cet article présente le mécanisme et les effets du stress sur le corps et le cerveau, et des moyens de le réguler.



1) Le stress : un mécanisme naturel dont les effets sur le corps et le cerveau peuvent devenir dangereux à long terme
Le stress de base est une réaction physiologique normale. C’est un mécanisme de défense de l’organisme qui s’active devant une situation considérée comme dangereuse, ou une situation nouvelle ou inattendue à laquelle nous n’avons pas encore pu nous adapter. C’est à l’origine un mécanisme sain de notre corps pour nous mettre en sécurité.
Le stress est géré par notre système nerveux et comprend trois phases.
Phase 1 : phase d’alarme
Face à une situation que le cerveau interprète comme un danger (perçu ou réel), l’amygdale se met en route et envoie un signal d’alarme à l’hypothalamus. Le cerveau active alors le mode « survie » en une fraction de seconde. Le système nerveux sympathique déclenche une véritable tempête hormonale via les glandes surrénales, situées au-dessus des reins.
Celles-ci libèrent plusieurs hormones pour préparer le corps à l’action en augmentant l’apport d’oxygène au cerveau et aux muscles.
- L’adrénaline et la noradrénaline.
Leur sécrétion entraine l’augmentation du rythme cardiaque et du flux sanguin, et une certaine tension musculaire. Elles permettent ainsi de favoriser la mobilisation des forces tant physiques que mentales.
- Le cortisol, qu’on appelle souvent « l’hormone du stress ».
Il augmente le taux de sucre dans le sang pour donner au cerveau et aux muscles l’énergie nécessaire pour affronter le stress. En parallèle, il inhibe les fonctions non essentielles sur le moment pour gérer le danger présumé (digestion,
système immunitaire…).
Grâce à ce processus d’adaptation, l’organisme est prêt à gérer la situation stressante en luttant, fuyant, ou se figeant. Habituellement, une fois la situation stressante gérée, le système nerveux parasympathique s’active afin de rétablir l’équilibre et ramener le calme au niveau de l’organisme.
En effet, notre organisme n’est pas programmé pour encaisser intensément du stress sur la durée. C’est pourquoi cette phase d’alerte n’est pas faite pour durer dans le temps. Quand le stress perdure et qu’il s’intensifie, il devient chronique et l’organisme rentre alors dans une phase d’endurance.
Phase 2 : phase d’endurance
Le stress chronique découle d’une exposition prolongée et répétée avec la situation stressante. Quand cette exposition perdure, le corps va entrer dans une deuxième phase : celle du développement de la résistance. L’organisme se retrouve en tension permanente car le mode mode « alerte » est activé en continu. Il va donc lutter pour s’adapter à ce stress et maintenir l’homéostasie. Afin d’augmenter notre résistance au stress, il sécrète encore plus de cortisol ainsi que des endorphines. Les endorphines rendent possible de supporter la douleur, réduisent l’anxiété et empêchent de ressentir la fatigue. En cela, elles permettent de rester calme et de lutter contre le stress.
Le piège, c’est que l’utilisation suractive de ces hormones ne peut avoir lieu que sur un temps donné. Quand ces hormones sont sécrétées sans interruption, un compte à rebours d’une durée inconnue (et propre à chaque personne) s’enclenche. Si cette phase de résistance au stress dure trop longtemps, les synapses dans le cerveau finissent par s’abîmer et bloquer le passage des neurotransmetteurs. Toutes les hormones et molécules qui nous permettent de nous mettre en action, de ressentir du bonheur, d’aider notre cerveau à agir, penser, réfléchir, réguler nos émotions et notre corps… se retrouvent bloquées et ne peuvent plus remplir leur fonction.
On entre alors dans la dernière phase d’épuisement.
Phase 3 : phase d’épuisement
Cette phase intervient lorsque l’organisme s’est tellement adapté qu’il a épuisé l’intégralité de ses ressources et capacités énergétiques. L’état d’épuisement devient alors un terrain propice à la somatisation, aux risques de dépression et de burn-out. Les cellules du corps sont fragilisées et le système neuro-hormonal est déréglé. Les organes commencent à défaillir et des maladies se déclenchent en raison d’une exposition trop forte et prolongée aux hormones du stress.
Le stress chronique impacte considérablement la bonne santé de l’organisme.
2) Les effets du stress sur le corps et le cerveau
Les effets du stress sur le corps et le cerveau sont nombreux, et deviennent progressivement de plus en plus dommageables.
1) Les effets du stress sur le corps
- Fatigue et troubles du sommeil
La production de cortisol étant déréglée car sur-sollicitée, elle perturbe nos cycles de sommeil. On peut avoir des difficultés à s’endormir en dépit d’une fatigue intense, ou connaitre des réveils nocturnes. Ou encore avoir l’impression que le sommeil n’est plus du tout réparateur. C’est un vrai cercle vicieux qui s’installe car plus le sommeil se dégrade, plus on est fatigué. Et plus on est fatigué, plus l’incapacité à réussir à dormir et récupérer génère du stress.
- Tensions musculaires et douleurs chroniques
Lorsque nous sommes stressés, nos muscles se contractent inconsciemment, surtout au niveau du dos, des épaules et de la mâchoire. Cela peut engendrer des maux de tête, voire des migraines, des douleurs cervicales, et des troubles digestifs.
- Affaiblissement du système immunitaire
Le stress chronique finissant par épuiser nos défenses naturelles, notre organisme se retrouve plus vulnérable aux infections, aux inflammations et aux maladies auto-immunes. On peut notamment voir se déclencher des allergies, avoir un taux de cholestérol qui augmente, du diabète ou encore un ulcère à l’estomac.
- Problèmes cardiovasculaires
À long terme, le cortisol et l’adrénaline sécrétés en abondance et sans interruption peuvent favoriser les maladies cardiovasculaires et l’hypertension.
- Déséquilibres hormonaux
Le stress perturbe les hormones responsables de la régulation de l’appétit, du métabolisme et de la fertilité. Certains prennent du poids, d’autres perdent l’appétit. Il n’est pas rare de constater une libido en berne, et chez les femmes une perturbation du cycle menstruel.

Je suis Julie Papuga, coach professionnelle certifiée et formatrice, fondatrice de CAPestella Coaching & Formation.
Spécialisée dans le surinvestissement au travail et le burn-out, j’aide les cadres surmenés de la finance et du conseil à retrouver la sérénité et un équilibre de vie, sans sacrifier leur performance et leur réussite professionnelle.
Passionnée par la psychologie et les mécanismes du cerveau, je propose un coaching en profondeur permettant aux personnes que j’accompagne de vivre une réelle transformation.
2) Les effets du stress sur le cerveau
Le stress chronique se répercute aussi sur l’état émotionnel, comportemental et sur la cognition.
- Altération de la mémoire et de la concentration
Un stress prolongé endommage l’hippocampe, une zone du cerveau qui joue un rôle important dans la mémoire et l’apprentissage. Sous l’effet d’un stress chronique, cette région du cerveau rétrécit, causant des pertes de mémoire, des oublis, des difficultés à se concentrer et à apprendre.
- Prise de décision altérée
Sous l’effet du stress, le cerveau privilégie les décisions rapides et instinctives plutôt que des décisions issues d’une véritable réflexion. On prend ainsi plus de mauvaises décisions, sous le coup de l’émotion.
- Augmentation de l’anxiété et de l’émotivité
Le stress stimule l’amygdale, la partie du cerveau responsable des émotions. Plus celle-ci est sollicitée, plus on devient sensible aux stimuli négatifs autour de nous. S’installe alors une fatigue émotionnelle qui implique une plus grande irritabilité, de l’impatience, une anxiété exacerbée voire de la paranoïa, pouvant donner lieu à des crises de nerfs ou d’angoisse.
- Risque de burn-out et de dépression
Tous ces effets sur le corps et le cerveau sont loin d’être anodins et peuvent mener à un épuisement professionnel extrême ou à une dépression.
3) Les effets du stress sur le corps et le cerveau : comment les réguler ?
Nous ne sommes pas tous égaux devant le stress.
Chaque personne y est plus ou moins vulnérable et s’y adapte avec plus ou moins d’aisance selon son vécu personnel, son état de santé, et sa perception des situations. La bonne nouvelle, c’est que tout le monde est capable d’acquérir les fondamentaux d’une bonne gestion du stress. Ça s’apprend !
Pour agir efficacement sur le stress, et limiter les effets de ce stress sur le corps et le cerveau, il est essentiel d’agir à deux endroits :
- Lorsqu’on ressent le stress : en trouvant des activités ou pratiques pour le canaliser et l’évacuer.
- En amont de son déclenchement : en développant certains apprentissages, en travaillant sur soi et sa perception des situations, on peut devenir moins vulnérable au stress et donc le ressentir moins souvent.
1) Trouver des activités ou pratiques pour canaliser et évacuer le stress
Pour lutter contre les effets négatifs du stress, se réguler et récupérer, le cerveau a besoin d’une chose : l’action. Le fait de se mettre en action va permettre qu’il se détourne et déconnecte de ce qui provoque le stress.
Il existe un certain nombre d’activités et pratiques dont les effets positifs sur le stress ont pu être démontrés :
– Relaxation mentale
- Faire une activité artistique : peindre, écrire, dessiner, sculpter…
- Ecouter de la musique
- Jouer d’un instrument de musique
- Parler avec des amis
- Aller dans la nature
- Lire…
– Relaxation physique
- Pratiquer une activité physique qui fait bouger : marcher, courir, faire du vélo, de la natation… Le sport, la marche ou même des étirements libèrent des endorphines, les hormones anti-stress naturelles.
- Jardiner
- Pratiquer un art martial ou du yoga : ce sont des pratiques qui conjuguent mouvements, maitrise du geste et concentration.
- Faire le ménage…
– Respiration : apprendre à véritablement respirer peut avoir énormément de bénéfices aussi bien sur le cerveau que sur le corps. La respiration profonde apporte une oxygénation au cerveau, et stimule le système parasympathique qui réduit le rythme cardiaque et favorise l’apaisement. Respirer est une première étape essentielle pour se calmer, se recentrer, et observer ce qui se passe en soi et ce qui génère ce stress.
2) Développer des apprentissages pour réduire sa vulnérabilité au stress
Avoir des techniques pour réguler le stress est très utile, afin d’en limiter les effets sur le corps et le cerveau. Mais il est encore plus bénéfique de développer des apprentissages pour que notre cerveau ne soit plus aussi souvent dans un sentiment d’inconfort et de stress. Agir sur nos perceptions des situations (notamment leur caractère menaçant à nos yeux) permet de développer de la sérénité et se préserver du stress.
– Apprendre à réguler ses émotions : pour s’autoriser à les ressentir et accepter leur existence. Le fait de comprendre le fonctionnement et la signification des émotions permet de mettre en place de nouveaux comportements.
– Adopter une façon plus positive de voir la vie : en faisant évoluer son rapport à l’échec, aux déceptions, aux problèmes. Ainsi, les difficultés deviennent des opportunités de nous mettre en action et enclencher des changements. Elles constituent des leçons et enseignements à tirer et non des sanctions.
– Apprendre à dire non : accepter ses limites et refuser certaines demandes est un levier essentiel pour réduire sa charge mentale et se préserver du stress.
– Apprendre à lâcher prise : accepter que certaines choses échappent à notre contrôle, et que l’imprévu fait partie de la vie permet de prendre du recul et de se détacher.
– Méditer régulièrement : pratiquée régulièrement, la méditation développe une meilleure sérénité générale, et aide à réguler son stress et ses émotions.
– Demander de l’aide et se faire accompagner : parfois, le stress est tellement avancé qu’une aide extérieure avec un coaching est nécessaire pour prendre du recul et reprendre le contrôle.
A retenir
Comment limiter les effets du stress sur le corps et le cerveau ?
L’exposition à une situation qui nous parait menaçante déclenche une réaction naturelle de défense. Si celle-ci est bénéfique à court terme, elle devient néfaste lorsqu’elle perdure. À force de mobiliser l’organisme, les effets du stress épuisent le corps et le cerveau, compromettant le bien-être physique et mental.
Apprendre à écouter son corps, comprendre les mécanismes du stress et adopter des activités pour évacuer les tensions sont des clés essentielles pour prévenir le stress chronique.
Je suis là pour vous accompagner à faire évoluer vos perceptions et à travailler sur vous-même, afin de réduire votre vulnérabilité au stress, et ressentir enfin plus de sérénité au quotidien. N’hésitez pas à me contacter pour me faire part de votre situation, et nous verrons ensemble comment je peux vous aider.


Les autres articles qui pourraient vous intéresser.
Comment se passe un coaching ?
Les 5 phases du burn-out
9 conseils pour renforcer la confiance en soi